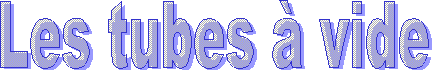
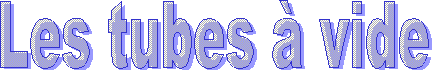
Les premiers tubes à vide
Le premier âge de l’électronique
Le contexte historique
Remarques
I- La diode thermoionique 1904
1.1 L’inventeur
3.3 Comparaison de la structure triode et pentode
Bibliographie
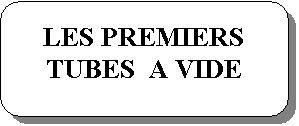
La plupart des grands systèmes électroniques furent crées grâce aux tubes. Le premier des tubes, historiquement, et l’un des plus important, fut le tube à rayons cathodiques. Dès 1859, un mathématicien allemand, Julius Plüker, avait observé les rayons émis par la cathode d’un tube à vide. Il avait utilisé une électrode négative chauffée (cathode) et étudié les variations des effets de lumière selon les différents degrés de raréfaction de l’air, et il avait constaté une fluorescence verdâtre du verre. Il avait alors suggéré que la cathode émette un rayonnement électrique, car s’il interposait un objet, il obtenait une ombre. Son élève Johan Hittorf établit que le rayonnement pouvait être dévié par un champ magnétique. Ces expériences seront à l’origine d’une autre découverte, celle de l’émission secondaire des électrons dont une grande partie de l’énergie, s’ils buttent contre un obstacle, se transforme en chaleur. Il est possible d’extraire de nouveaux électrons dits électrons secondaires, si l’énergie cinétique est suffisante. Ce phénomène sera fréquemment utilisé en électronique.
Le physicien anglais William Crookes reprend ces expériences. Il étudie le passage du courant à travers les tubes à où le gaz se réduit à quelques molécules pour montrer les effets lumineux dans les décharges électriques en atmosphère gazeuse. La lumière disparaît dans l’ampoule, mais une clarté verte baigne les parois. En 1879, il monte dans le tube un moulinet, que font tourner les rayons cathodiques. Il pense qu’en fait, il s’agit de molécules et il estime qu’il a découvert un quatrième état de la matière, l’état radiant. Parallèlement il met au point le tube dit tube de Crookes qui émet des rayonnements que Röntgen baptisera plus tard Rayons X, étant incertain de leur véritable nature : dans le tube de Crookes, les rayons cathodiques qui frappent une anode à haute tension y excitent des rayons X.
Dans les deux cas Crookes n’identifiera pas la nature des rayons émis par ses appareils. On raconte à ce sujet une anecdote : Crookes travaillait à son tube sur une table dans le tiroir de laquelle un autre savant avait oublié des plaques photographiques qui se trouvèrent voilés. Quand l’autre se plaignit, Crookes luit répondit simplement : « il fallait les mettre ailleurs », sans se soucier outre mesure du phénomène. Faut-il souligner que Henry Becquerel découvrit la radioactivité à partir d’un incident analogue ? Et pourtant l'étude de Crookes fut à la base de la découverte de Rötingen, et le tube cathodique devait devenir une base de l’électronique naissante. Dès 1893 en effet, c’est à un Français, André Blondel que revient l’idée du premier oscilloscope électromagnétique pour l’étude des courants variables. Trois ans plus tard, l'allemand Ferdinand Braun met au point son tube cathodique qui sera l’ancêtre des tubes-images de la télévision.
A Strasbourg, Jonathan Zenneck est devenu avec Mathias Cantor, l’assistant de celui qui fut son ancien professeur, Braun, Röntgen vient de découvrir les rayons X et Braun reprend les expériences à partir du tube de Röntgen, mais surtout désire prolonger les travaux de Crookes. Le 15 février 1887, il présente un nouveau tube de son invention, à cathode froide et atmosphère gazeuse à basse pression. Dans ce tube il rassemble plusieurs ingrédients déjà connus : rayons cathodiques, illumination d'un écran phosphorescent par un rayon cathodique, possibilité de diriger les rayons par un champ magnétique.
Dans son tube, les rayons cathodiques sont émis en ligne droite par une cathode située sur la gauche du tube. Un trou dans un petit disque de métal placé au milieu du tube laisse seulement passer un pinceau qui produit un point lumineux sur un écran placé sur la droite du tube. Mais le déplacement de celui-ci ne permet que de déplacer le point dans un plan. En1899, Zenneck ajoute au dispositif de Braun deux bobines orthogonales permettant d’obtenir un déplacement à la fois à la verticale et à l’horizontale.

Un nouveau domaine scientifique l'électronique
L'histoire de l'électronique est indissociable de celle de la radio. Ce furent en effet les hommes engagés dans la mise au point de ce nouveau mode de communication qui développèrent les premiers composants électroniques. Hors de toute démarche réellement scientifique, ces chercheurs élaborèrent les bases d'un nouveau domaine technologique. A partir des travaux théoriques de Maxwell, le physicien Hertz mit en évidence l'existence des ondes électromagnétiques en 1887. Il publia ses résultats en 1888 dans un article intitulé " La propagation de la force électrique ". Cette année marque la naissance de la radio technique. L'existence de ces ondes prouvée, de nombreux chercheurs tentèrent de construire des appareils capables de les créer et de les détecter. Une première approche, utilisa les techniques électriques, l'autre, fondée sur les courants faibles, donna naissances à l'électronique.
Contexte historique
Il faut remonter à 1840, avec le télégraphe électrique de Morse, pour bien comprendre le cheminement de la pensée qui a conduit à la création des tubes électroniques. L'homme a alors réalisé un de ses vieux rêves : la transmission de l'information à grande distance grâce à un réseau de fils. Mais les signaux électriques, très affaiblis, deviennent inutilisables au-delà de quelques dizaines de kilomètres. Il faut donc installer des relais, d'abords humains puis électromécaniques.
Pendant que des savants W. Crookes en Grande-Bretagne mais aussi J. Perrin en France développèrent d'importantes expériences qui débouchèrent sur la théorie de Lorentz et la mise en évidence de l'électron. Cela afin de préciser leurs vues sur la théorie électronique de la matière, d'autres chercheurs se mettaient à utiliser l'électron à des fins pratiques. L'histoire des composants électroniques ne commence cependant qu'avec la conception, par des chercheurs engagés dans le développement de la radio, de la lampes à vide pouvant créer un courant électronique.
Remarques
On appelle courant alternatif, un courant dont la valeur moyenne temporelle est nulle.
On appelle courant sinusoïdale, un courant alternatif de forme sinusoïdale.
On appelle courant continu, un courant dont la valeur moyenne temporelle est non nulle.
On l'appelle tout de même courant continu, bien qu'il ne soit pas du type courant continu délivré par une pile de Volta.
I- La diode thermoionique 1904
1.1 L'inventeur
![]()
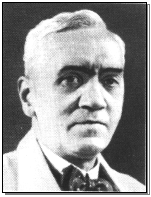 Sir John Ambrose Fleming était un ingénieur électricien britannique, né à Lancaster
[1849-1945]. Ce fut l'un des pionniers de la radiotélégraphie. Il travailla
à l'Edison Electric Light Company à Londres et s'intéressa à l'effet
Edison à partir de 1882. Le 17 mars 1896, dans une communication présentée à
la Physical Society, il notait que même si le filament de la lampe était
alimenté en courant alternatif, le courant qui s'établissait vers une électrode
séparée était unidirectionnel : le système se comportait donc comme un redresseur.
Il fut l'assistant de Marconi, il fit réaliser des ampoules d'Edison et constate
qu'elles permettent de transformer du courant alternatif en courant continu.
Il baptise son ampoule du nom de valve ou soupape, par analogie avec
la valve hydraulique qui ne laisse passer l'eau que dans un seul sens. C'est
le physicien W.H. Eccles qui la baptisa diode. On notera que Fleming
n'a pas inventé le dispositif, mais son application à la détection des signaux
radio.
Sir John Ambrose Fleming était un ingénieur électricien britannique, né à Lancaster
[1849-1945]. Ce fut l'un des pionniers de la radiotélégraphie. Il travailla
à l'Edison Electric Light Company à Londres et s'intéressa à l'effet
Edison à partir de 1882. Le 17 mars 1896, dans une communication présentée à
la Physical Society, il notait que même si le filament de la lampe était
alimenté en courant alternatif, le courant qui s'établissait vers une électrode
séparée était unidirectionnel : le système se comportait donc comme un redresseur.
Il fut l'assistant de Marconi, il fit réaliser des ampoules d'Edison et constate
qu'elles permettent de transformer du courant alternatif en courant continu.
Il baptise son ampoule du nom de valve ou soupape, par analogie avec
la valve hydraulique qui ne laisse passer l'eau que dans un seul sens. C'est
le physicien W.H. Eccles qui la baptisa diode. On notera que Fleming
n'a pas inventé le dispositif, mais son application à la détection des signaux
radio.
1.2 Le premier tube a vide : la diode thermoionique
![]()
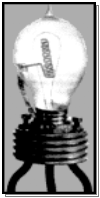 Le premier tube à vide fut mis au point par Fleming, conseiller de Marconi.
En s'inspirant d'anciens travaux menés par Edison, il réalisa une lampe dotée
de deux électrodes, une diode. La cathode, échauffée par le passage d'un
courant électrique, émettait des électrons, c'est l'effet Edison. Fleming en
ajoutant une seconde électrode, une plaque de métal, dirigea le flux d'électrons
de la cathode vers la plaque lorsque celle-ci était chargée négativement. La
diode était donc une sorte de porte laissant passer, ou au contraire coupant,
le flux électronique. Il parvint ainsi à créer le premier système électrique
permettant de redresser le courant alternatif en courant continu, qu'il
fit breveter dès 1905. Il avait de plus remarquer la possibilité de détecter
les oscillations électriques à l'aide de son invention. Au cours des années
suivantes, de nombreuses découvertes et améliorations contribuèrent à la mise
au point des tubes à vide modernes, à partir de la diode de Fleming.
Le premier tube à vide fut mis au point par Fleming, conseiller de Marconi.
En s'inspirant d'anciens travaux menés par Edison, il réalisa une lampe dotée
de deux électrodes, une diode. La cathode, échauffée par le passage d'un
courant électrique, émettait des électrons, c'est l'effet Edison. Fleming en
ajoutant une seconde électrode, une plaque de métal, dirigea le flux d'électrons
de la cathode vers la plaque lorsque celle-ci était chargée négativement. La
diode était donc une sorte de porte laissant passer, ou au contraire coupant,
le flux électronique. Il parvint ainsi à créer le premier système électrique
permettant de redresser le courant alternatif en courant continu, qu'il
fit breveter dès 1905. Il avait de plus remarquer la possibilité de détecter
les oscillations électriques à l'aide de son invention. Au cours des années
suivantes, de nombreuses découvertes et améliorations contribuèrent à la mise
au point des tubes à vide modernes, à partir de la diode de Fleming.
1.3 L'étude du phémnomène thermoionique
En étudiant l'émission des oxydes métalliques d'un fil de platine, le physicien allemand Arthur Wehnelt [1871-1944] découvrit accidentellement la cathode à oxydes en 1903. Il observa une émission dans certaines régions du fil, à une température trop basse pour qu'elle puisse être attribuée au fil lui-même: il supposa qu'elle était due à des impuretés et après avoir examiné systématiquement l'émission des oxydes métalliques, il conclut que les oxydes alcalino-terreux sont les meilleurs émetteurs thermoionique. De nombreux auteurs se mirent à étudier le mécanisme de la cathode à oxydes, mais il fallut attendre la théorie des semi-conducteurs pour comprendre son fonctionnent dont plusieurs points restaient encore obscurs. Cela n'a pas empêché son utilisation dans presque tous les tubes de réception radioélectrique.
1.4 L'utilisation du tungstène dans les lampes
Vers 1910, l'ingénieur chimiste et physicien Irving Langmuir [1881-1957] travaillait au laboratoire de la General Electic Company à l'amélioration des lampes à incandescence et la mise au point de tubes à rayon X à vide poussé. Chimiste de formation, il effectua de brillant travaux sur le tungstène qui permirent de réaliser des lampes à incandescence à grand rendement et des cathodes pour tubes à vides. En 1913, Langmuir publia une étude très importante sur les facteurs qui réduisent l'émission thermo-ionique à une valeur inférieure à celle de la formule de Richardson. Grâce à ses travaux sur les lampes à filament de tungstène, il put résoudre le problème de l'émission d'électrons dans le vide parfait par les métaux purs. Il découvrit aussi l'atome d'hydrogène ionisé. A titre d'information Owen Richardson [1879-1959] était un physicien anglais qui obtenu le prix Nobel pour sa découverte des lois de l'émission thermoélectronique en 1928.
1.5 Etablissement de la loi électrocinétique
Tout d'abord, les électrons émis forment une charge d'espace négative qui limite l'émission pour les hautes températures de la cathode et les faibles tensions de l'anode : Langmuir établit que le courant est proportionnel à la tension d'anode puissance trois demis, jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur de saturation donnée par la loi de Richardson. En fait, Clild avait établi, en 1911, une formule analogue pour un courant d'ions positifs. Le travail de Langmuir qui portait sur les diodes à électrodes planes fut complété par une étude de Langmuir et W. Blodgett sur les électrodes sphériques et cylindriques en 1923 qui tient compte de la répartition des vitesses des électrons émis par la cathode.
1.6 Vers une utilisation industrielle des 1915
Langmuir, ayant étudié l'effet des gaz résiduels sur le courant émis, porta son attention sur la technique du vide. En 1916, il réalisa la pompe à condensation à vapeur de mercure, forme considérablement améliorée de la pompe à diffusion inventée par W. Gaede en 1915. Les progrès de la technique du vide permirent le véritable début de la carrière des tubes électroniques. Ainsi, en 1915, Dushman, collaborateur de Langmuir fabriqua une diode à vide poussée, permettant de redresser des courants élevés sous de fortes tensions, qu'il désigna sous le nom de kénotron et qui trouva rapidement de nombreuses applications. La diode de Fleming constitua cependant un détecteur efficace et stable, largement utilisé, bien qu'il fût incapable d'amplifier les signaux électriques.
![]()
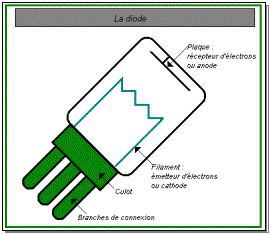 |
II- La triode et l'audion 1906
2.1 L'inventeur
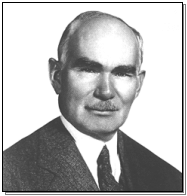
Lee De Forest est un ingénieur américain, né à Council Bluffs (Iowa) [1873-1961]. Il déposa un brevet d'invention le 29 janvier 1907 pour la lampe à triode. Du fait de la similitude avec la diode de Fleming, ce qui engendra une polémique, et retardera la reconnaissance au sein de la communauté scientifique dûment mérité.
![]()
2.2 La naissance de l'électronique appliquée : la triode
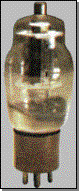
Plus déterminante, véritable naissance de l'électronique appliquée, fut la réalisation de l'américain L. De Forest de la triode ou audion. Ce chercheur "essayait un montage, puis un autre, inventant ce qu'il pouvait, empruntant, pour utiliser un terme de neutre, ce qu'il ne découvrait pas par lui-même. "L'ironie réside dans le fait qu'il fut l'homme qui inventa la lampe triode, l'élément qui allait dominer la technologie radio pour le demi-siècle suivant", a dit H. Aitken. En ajoutant par hasard une simple grille entre la cathode et la plaque à la diode de Fleming, Lee De Forest parvint en effet à amplifier le courant reçu. Il va plus loin et débouche sur un détecteur perfectionné. Une multitude d'applications devenait possible. C'est encore le physicien W. H. Eccles qui la baptisa triode.
![]()
2.3 Un développemnt industriel paralisé
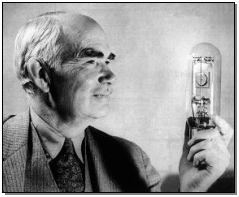
![]() Le brevet de Fleming, déposé en 1904, et celui de Lee De Forest, déposé en 1906,
furent opposés lors de long procès qui bloquèrent pendant plusieurs années le
véritable développement industriel de leur production. De Forest connu d'importantes
difficultés aux Etats-Unis pour appliquer ses idées. Un jugement du tribunal
de New-York en 1912 considéra même que l'audion " était dénué d'intérêt
et que le public avait été induit en erreur". Celui qui fut par la suite
considérer comme l'un des innovateurs les plus important du siècle fut ainsi
interpellé par le juge à la suite de son acquittement : "votre chance est
grande, Monsieur, d'esquiver une punition ainsi méritée... reconnaissez le,
en renonçant au titre d'inventeur", a cité A. Vasseur.
Le brevet de Fleming, déposé en 1904, et celui de Lee De Forest, déposé en 1906,
furent opposés lors de long procès qui bloquèrent pendant plusieurs années le
véritable développement industriel de leur production. De Forest connu d'importantes
difficultés aux Etats-Unis pour appliquer ses idées. Un jugement du tribunal
de New-York en 1912 considéra même que l'audion " était dénué d'intérêt
et que le public avait été induit en erreur". Celui qui fut par la suite
considérer comme l'un des innovateurs les plus important du siècle fut ainsi
interpellé par le juge à la suite de son acquittement : "votre chance est
grande, Monsieur, d'esquiver une punition ainsi méritée... reconnaissez le,
en renonçant au titre d'inventeur", a cité A. Vasseur.
La recherche sur les composants électronique n'était pas menée uniquement par les entreprises spécialisées en radiocommunications. Le laboratoire de l'ATT fut séduit par les performances de la triode de Lee De Forest, il le préférèrent parce qu'il la trouvèrent robuste et fiable. Les puissants laboratoires Bell menaient parallèlement leurs recherches afin de disposer, écrivait dès 1909 le président de l'American Telephone and Telegraph (ATT), "d'un récepteur téléphonique qui non seulement nous permettrait de développer nos services, mais nous placerait en position pour contrôler le développement des liaisons sans fil", a cité L. Hoddeson, le géant du téléphone disposait donc de brevets clefs dès 1914.
2.4 Lee De Forest un génie créateur
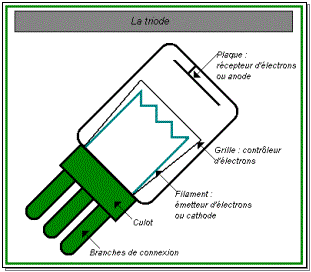 Vers
1903, Lee De Forest cherchait un détecteur pour les ondes hertziennes. Après
plusieurs essais, il fut amener à placer dans une ampoule vide une électrode
chaude et une électrode froide qu'il reliait, respectivement à la terre et au
circuit d'utilisation, en série avec une batterie. L'antenne de réception était
raccordée à une feuille métallique entourant l'ampoule, puis à partir de 1906
à une troisième électrode interne qui prit en 1907 la forme d'une grille placée
entre la cathode et l'anode.
Vers
1903, Lee De Forest cherchait un détecteur pour les ondes hertziennes. Après
plusieurs essais, il fut amener à placer dans une ampoule vide une électrode
chaude et une électrode froide qu'il reliait, respectivement à la terre et au
circuit d'utilisation, en série avec une batterie. L'antenne de réception était
raccordée à une feuille métallique entourant l'ampoule, puis à partir de 1906
à une troisième électrode interne qui prit en 1907 la forme d'une grille placée
entre la cathode et l'anode.
![]() Il avait mis au point la triode, où l'anode reçoit un courant qui est modulé
par un autre appliqué à la troisième électrode avant d'être recueilli sur la
cathode. On peut ainsi amplifier un signal électrique appliqué à la troisième
électrode. C'est le principe du transistor, qui n'apparaîtra qu'en 1948.
Il avait mis au point la triode, où l'anode reçoit un courant qui est modulé
par un autre appliqué à la troisième électrode avant d'être recueilli sur la
cathode. On peut ainsi amplifier un signal électrique appliqué à la troisième
électrode. C'est le principe du transistor, qui n'apparaîtra qu'en 1948.
Il y eut plusieurs applications directes suite aux travaux de Lee De Forest, les tubes à vides sont à l'origine des tubes cathodiques, élément principal du récepteur de télévision et des écrans d'ordinateur. Ce sont encore des évolutions du tube à vide que l'on utilise pour les radars et les rayons X.
|

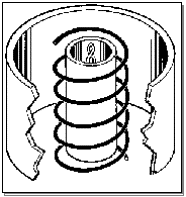
|
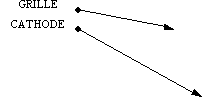 |
|||
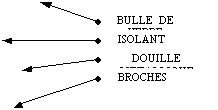 |
|||
![]()
Lee de Forest avait ainsi réalisé la première lampe à trois électrodes, l'audion, ancêtre des triodes modernes. Elle fut utilisée comme détecteur uniquement jusque vers 1912. Cependant, la présence d'une électrode de commande en faisait un relais susceptible d'amplifier les signaux reçus. Cherchant à l'utiliser comme amplificateur en 1911, F. Lowenstein éprouvait de grandes difficultés, dues au vide insuffisant régnant dans le tube. Il réussit cependant et, l'année suivante, il déposa le brevet de l'amplificateur classe A, celui où la triode fonctionne en régime linéaire.
2.5 La triode un enjeu militaire
Au moment de la Première Guerre Mondiale, en France, les communications militaires sont dirigées par un officier de premier plan, Gustave Ferrié, passionné par la télégraphie sans fil. Avec l'aide de physiciens d'ingénieurs chevronnés, il parvient à créer une triode performante, la lampe triode militaire TM, qui sert à réaliser des matériels de nouveaux types : récepteurs perfectionnés, émetteurs mobiles, appareils de télégraphie par le sol… qui mettent l'Armée et la Marine française au premier rang des belligérants dans le domaine radioélectrique. La paix revenue, le général s'intéresse à la radiodiffusion naissante et décide de procéder, à partir de la tour Eiffel, à des émissions comportant des informations, des conférences, des cours commerciaux et concerts qui connaissent un succès considérable. La fabrication des lampes, en veilleuse depuis la fin de la guerre, reprend de plus belle.
2.6 L'industrialisation de la production
La première guerre mondiale, en rendant secondaires ces problèmes juridiques, accéléra la diffusion de la triode et permit notamment en France, l'industrialisation de la production. La lampe triode militaire TM, développée par les services du colonel Ferrié, équipa toutes les armées alliées. Elle était fabriquée au rythme de mille unités par jour au moment de l'Armistice. Grâce à des méthodes de fabrication permettant d'obtenir, un vide de plus en plus poussé, au scellement verre-métal mis au point par les laboratoires Bell en 1922, à l'utilisation de nouveaux métaux plus performants pour les électrodes, les performances des tubes électroniques s'améliorèrent très rapidement dès le début des années 1920. L'emploi du tungstène recouvert d'oxyde de baryum développé par les sociétés Westinghouse et Philips, augmenta non seulement les possibilités des lampes mais aussi leur durée de vie. A la fin des années 1930, de nouveaux montages, jusqu'alors expérimentaux, s'intégrèrent dans la production commerciale. A titre d'exemple, la production de triodes japonaises était de dix millions d'unité en 1915 pour atteindre vingt quatre millions d'unité en 1925.
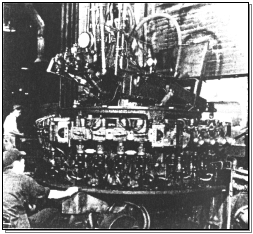
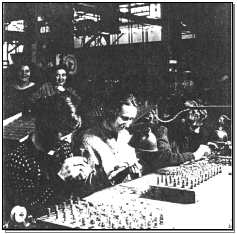
![]()
![]()
En 1915, Langmuir apporta un progrès décisif avec la réalisation du pliotron, triode à vide poussée, dont le fonctionnement n'était pas troublé par l'ionisation du gaz résiduel. Dans ces conditions, les tubes à vide possèdent une grande souplesse d'emploi qui fit leur succès. De multiples sociétés en firent le commerce au début des années 1920, ce fut l'explosion de la publicité des composants électroniques et autres kits pour les électroniciens du dimanche. Les possibilités des tubes à vide furent encore accrues par l'introduction de grilles supplémentaires : invention de la tétrode ou tube à quatre électrodes par Hull et Schottky en 1916, suivit de la découverte de la pentode par le hollandais B. Tellegen en 1928.

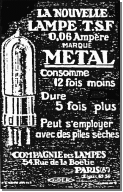
![]()
![]()
III- L'apogée de cette technologie : tetrode et pentode
3.1 La tetrode
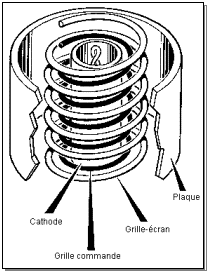
Il apparaît très vite que l'augmentation des grilles favorise les performances des récepteurs qui gagnent en sensibilité, en qualité acoustique, en puissance. Ce tube dispose de quatre électrodes et prend le nom de tétrode. On monte une seconde grille dont le pas est plus serré que celui de la première et soustrait ainsi assez efficacement, par un effet d'écran, la région de la cathode à l'influence de l'anode ; D'où son nom de grille-écran.
![]() La tétrode avait réussi à corriger les deux points faibles de la triode : sa
capacité anode - grille et sa faible résistance interne, qui limitait le gain
en tension et le domaine fréquentiel. Cependant, la présence de la grille-écran
portée à un potentiel presque aussi élevé que celui de l'anode, provoque un
effet secondaire indésirable. Cet effet provient de l'émission secondaire d'électrons
à la surface de l'anode, ce qui détériore considérablement le gain en courant
aux fortes tensions.
La tétrode avait réussi à corriger les deux points faibles de la triode : sa
capacité anode - grille et sa faible résistance interne, qui limitait le gain
en tension et le domaine fréquentiel. Cependant, la présence de la grille-écran
portée à un potentiel presque aussi élevé que celui de l'anode, provoque un
effet secondaire indésirable. Cet effet provient de l'émission secondaire d'électrons
à la surface de l'anode, ce qui détériore considérablement le gain en courant
aux fortes tensions.
3.2 La pentode
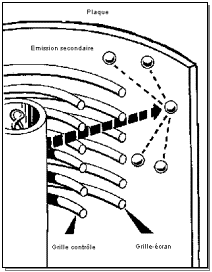 La
troisième grille d'une pentode a précisément pour fonction de supprimer les
effets nocifs de l'émission secondaire. Cette grille dite d'arrêt, est montée
entre la grille-écran et l'anode ; elle est maintenue au potentiel de la cathode
et dans la plupart des tubes est reliée directement à celle-ci. De cette manière,
on crée un minimum de potentiel, entre la grille-écran et l'anode qu'aucun électron
ne peut franchir. Rappelons que les électrons secondaires sont ici émis à faible
énergie. En définitive, chaque fois qu'un électron secondaire sera émis à la
surface de l'anode ou de la grille-écran, il ne pourra retomber là d'où il vient
La
troisième grille d'une pentode a précisément pour fonction de supprimer les
effets nocifs de l'émission secondaire. Cette grille dite d'arrêt, est montée
entre la grille-écran et l'anode ; elle est maintenue au potentiel de la cathode
et dans la plupart des tubes est reliée directement à celle-ci. De cette manière,
on crée un minimum de potentiel, entre la grille-écran et l'anode qu'aucun électron
ne peut franchir. Rappelons que les électrons secondaires sont ici émis à faible
énergie. En définitive, chaque fois qu'un électron secondaire sera émis à la
surface de l'anode ou de la grille-écran, il ne pourra retomber là d'où il vient
![]() Ainsi
dotée d'une structure de trois grilles placées entre la cathode et l'anode et
portées à des tensions convenables, la pentode offre des caractéristiques de
fonctionnement qui satisfont à la presque totalité des conditions nécessaires
à l'amplification. Sa construction peut être optimisée pour servir d'amplificateur
de puissance à haute fréquence et hyperfréquence.
Ainsi
dotée d'une structure de trois grilles placées entre la cathode et l'anode et
portées à des tensions convenables, la pentode offre des caractéristiques de
fonctionnement qui satisfont à la presque totalité des conditions nécessaires
à l'amplification. Sa construction peut être optimisée pour servir d'amplificateur
de puissance à haute fréquence et hyperfréquence.
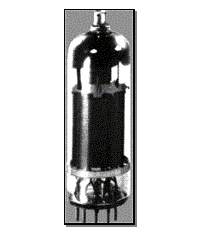
![]() La
pentode donna d'excellents résultats notamment pour l'amplification. Sous l'impulsion
du développement du médium radiophonique l'électronique était devenue une industrie
de poids considérable. Plus de cent millions de lampes de réceptions furent
fabriquées dans le monde en 1930. Dans le même temps la puissance des lampes
d'émission avait cru rapidement. Celle-ci, pour les modèles opérationnels, atteignait
50 watts en 1917. Dès 1920, la puissance passait à 250 watts, le kilowatt étant
atteint en 1922. Les problèmes d'échauffement liés à cette augmentation de puissance
furent résolus par des systèmes de refroidissement à eau. Un modèle de 8 kilowatts
fut employé par la Marine nationale à partir de 1924. En 1927, La General
Electric atteignait 100 kilowatts.
La
pentode donna d'excellents résultats notamment pour l'amplification. Sous l'impulsion
du développement du médium radiophonique l'électronique était devenue une industrie
de poids considérable. Plus de cent millions de lampes de réceptions furent
fabriquées dans le monde en 1930. Dans le même temps la puissance des lampes
d'émission avait cru rapidement. Celle-ci, pour les modèles opérationnels, atteignait
50 watts en 1917. Dès 1920, la puissance passait à 250 watts, le kilowatt étant
atteint en 1922. Les problèmes d'échauffement liés à cette augmentation de puissance
furent résolus par des systèmes de refroidissement à eau. Un modèle de 8 kilowatts
fut employé par la Marine nationale à partir de 1924. En 1927, La General
Electric atteignait 100 kilowatts.
![]()
![]()
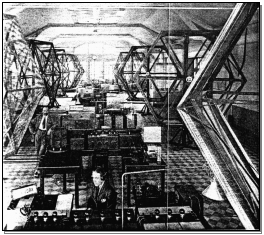
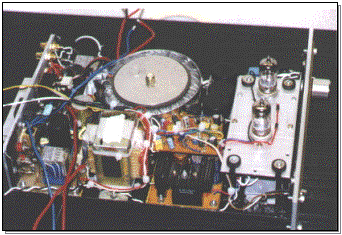 |
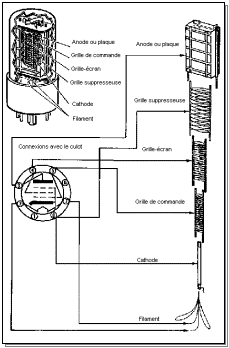 |
![]()
![]()
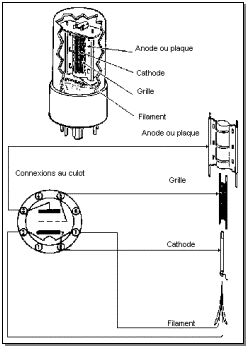
IV- Conclusions et discussion
Depuis le début de leur fabrication industrielle jusqu'à leur arrêt, soixante ans plus tard, les tubes font aussi l'objet de nombreuses recherches expérimentales dans les secteurs de la chimie, de la physique, voire de la métallurgie. On élimine les dépôts polluants grâce aux travaux sur le vide, on élabore de nouveaux métaux purs grâce à la métallurgie des poudres, et les isolants - verre, mica et céramiques progressent considérablement. Les producteurs parviennent ainsi à fabriquer des tubes en verre miniatures et subminiatures auxquels leurs faibles dimensions confèrent les qualités de robustesse requises.
A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les services rendus par les tubes étaient tels qu'on aurait pu penser que les différentes applications de l'électronique ne pourraient jamais se passer d'eux et qu'ils n'évolueraient plus qu'en formes et en dimensions. On se trompait car, en 1947, trois ingénieurs américains découvrent un nouveau dispositif doué de propriétés remarquables : le transistor. Dès 1950, on mit sur le marché des récepteurs portatifs. Désormais les tubes de réception sont condamnés et leur fabrication en grande série s'arrête aux environs de 1975.
Aujourd'hui même, l'invention de la triode présente un curieux paradoxe : alors que personne ne discute le nom de celui qui le premier a breveté la triode comme moyen d'amplifier des signaux électriques de faible amplitude, on a peut sérieusement se demander s'il avait réellement su évaluer à l'époque tout ce dont était capable le nouveau tube, comment il marchait et comment on pouvait s'en servir. Pendant de longues années, la triode allait pourtant demeurer le seul dispositif d'amplification et d'émission de signaux radioélectriques en détrônant tous les procédés antérieurs de radiocommunication.
Avec les tubes électroniques, l'homme disposait, pour la première fois dans son histoire technique, d'un moyen permettant une amplification, pratiquement sans limites de signaux électriques et donc toute information de quelque autre nature qu'elle soit. Cette idée d'amplification de signal ne s'est vraiment imposée qu'avec l'apparition des télécommunications, quand le besoin s'en est fais sentir. Mais peut-être faut-il se demander si la nature ne l'a pas mise en jeu et, si oui, comment elle l'a fait.
 |
[1] History of electronics tubes
Edité par S.Okumura en 1994
[2] L’aventure de l’électricité par Le prince ringuet ( académie française)
L’odyssée Flammarion
[3] Histoire de la lampe radio – guide du collectionneur par B.Machard
Edition Lacour , collection Eruditae 1989
[4] La brande épopée de l’électronique de Elisabeth Antébi
Editions Hologramme en 1982
[5] Histoire des sciences et techniques
Collection Maupertuis n°2 CRDP Rennes
[6] L’électronique, de l’éclateur de Hertz au microprocesseur
par J. Rosmorduc et O.Brezel
De nombreux sites Internet notamment pour les illustrations